Olivier Mercier
Olivier Mercier est candidat à la maîtrise avec mémoire en études internationales, option relations internationales à l’Institut québécois des Hautes études internationales (HEI). Il complète simultanément un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en droit international et transnational à l’Université Laval et est détenteur d’un baccalauréat intégré en Affaires publiques et relations internationales avec profil international à l’Institut d’études politiques de Strasbourg. Il s’intéresse particulièrement aux aspects sécuritaires et juridiques touchant les relations internationales et les conflits armés et est membre-étudiant du Centre sur la sécurité internationale (CSI). En plus d’avoir collaboré à la Clinique de droit international et humanitaire (CDIPH) en 2015, Olivier a également été auxiliaire de recherche au département de science politique de l’Université Laval et y occupe actuellement le poste d’auxiliaire d’enseignement (automne 2015).
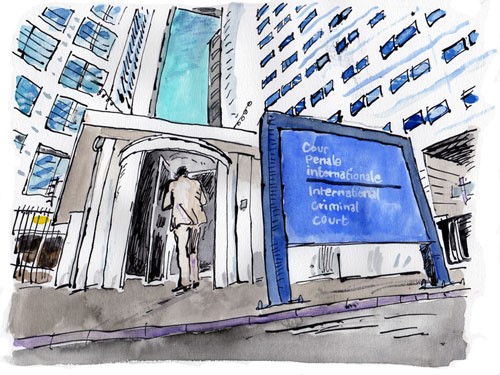
© Jean-Pierre Harambat, source : Amnesty.fr.
Les détracteurs de la Cour pénale internationale (CPI) semblent plus nombreux, ou du moins plus visibles que ses supporteurs depuis un certain temps. L’une des critiques particulièrement récurrentes est celle de la « politisation » de la CPI, et ce à presque tous les égards, du processus d’ouverture des enquêtes à la délivrance des mandats en passant par la coopération avec les États. Peu importe ce qu’elle fait, la Cour (et particulièrement le Bureau du Procureur) est fustigée, et les critiques lui étant adressées ‒ souvent tout à fait légitimes et fondées ‒ s’inscrivent la plupart du temps dans une dyade d’idées complètement opposées où chaque action de la CPI est critiquable par les arguments inverses.
Conséquemment, le présent billet explorera cet insurmontable « piège de critiques » dans lequel se trouve la CPI en ce qui a trait aux enjeux de la sélection des affaires et des poursuites, à la lumière de la théorie avancée par le professeur Darryl Robinson (Université Queen’s) dans une intervention dans le cadre de l’école d’été sur la justice internationale à l’Université Laval en mai 2015. Ce billet reposera donc en partie sur sa présentation et sur la publication[1] à l’origine de celle-ci. Certains éléments de la théorie de Robinson concernant l’éventail de critiques à l’égard de la CPI seront repris pour être traités plus spécifiquement à l’aide d’exemples factuels. Par ailleurs, le lien avec les accusations d’utilisation politique de la Cour par les grandes puissances, en l’espèce les États-Unis d’Amérique, sera abordé.
Deux écoles de pensée en droit international pour critiquer la Cour
Il arrive fréquemment que l’on puisse formuler une même critique pour contrer un argument en utilisant deux raisonnements diamétralement opposés. Cette dichotomie fait en sorte qu’il est possible de critiquer la CPI peu importe ce qu’elle fait, ce qui la piège entre deux pôles opposés. Il est possible de regrouper les critiques adressées à la Cour pénale internationale en deux écoles de pensée de l’argumentation juridique formulées[2] par Martti Koskenniemi, puis reprises par Darryl Robinson. Ce sont les critiques de « l’utopie » (utopia) et de « l’apologie » (apologia)[3]. Dans le cas qui nous intéresse, une critique de la CPI est dite de type apologia lorsqu’elle reproche à la Cour d’être trop près du pouvoir politique des États (des grandes puissances en particulier) et de leurs intérêts[4]. Inversement, une critique de type utopia met l’accent sur le fait que la CPI est trop déconnectée de la réalité politique de la sphère internationale et que, faute d’un certain appui politique ou social, elle fait abstraction de toute une gamme d’éléments importants qui devraient être considérés dans le processus de justice internationale. Ainsi, selon l’école de l’utopia, en voulant « s’imposer par le haut », la CPI pourrait être inefficace, voire néfaste dans certaines situations bien précises[5]. Adhérer à l’école de « l’utopie » ne signifie en aucun cas être un utopiste. C’est plutôt reprocher à la CPI d’être dans une certaine mesure trop utopiste; à l’inverse, l’école de « l’apologie » reproche à la CPI une trop grande inertie, une trop grande prudence et surtout une trop grande déférence à l’égard des États (souveraineté, puissance économique, pouvoir des membres permanents du Conseil de sécurité sur la CPI, etc.).
L’ouverture des affaires et le Bureau du Procureur : viser soit trop haut soit trop bas ?
Peu importe le mode de saisine[6] employé par la Cour, il sera possible de critiquer la « sélection du dossier » par la CPI tant par utopia que par apologia. Les tenants des deux écoles de pensée pourront qualifier cette manœuvre de politique, mais pour des raisons totalement opposées. D’abord, dans une situation donnée, il sera possible pour l’école de l’utopia de reprocher à la Cour de « viser trop haut » et ainsi de manquer de réalisme en voulant s’intéresser à une situation dite sensible pour un ou plusieurs États influents ou potentiellement nuisible au bon fonctionnement de la CPI lors de l’ouverture d’une affaire. Dans un tel cas, la Cour étant tributaire des États à bien des égards ‒ pour la mise en œuvre des mandats d’arrêts internationaux par exemple ‒, elle risque de se décrédibiliser et de se rendre inefficace en se butant à la mauvaise foi des gouvernements « dérangés » par les activités de la CPI[7]. Le choix d’entamer des procédures est alors politique selon ce point de vue, puisqu’il fait fi d’éléments externes pour, à tout prix, mener à bien le mandat de la Cour. Ce choix sera alors exposé à la critique d’être dogmatique, d’être « imposé par le haut », sans égard au contexte. C’est une critique qui revient dans les débats suscités par l’adhésion récente de la Palestine à la CPI et qui a été formulée à la suite de l’ouverture d’un examen préliminaire par la Procureure en chef, Fatou Bensouda, au sujet de crimes allégués dans la situation palestinienne.
D’un autre côté, du point de vue des tenants de l’apologia, il est tout à fait possible de critiquer la Cour pénale internationale en lui reprochant de « viser trop bas » dans le choix de certains de ses dossiers. En ne s’intéressant qu’à des crimes commis essentiellement en Afrique, la Cour évite de se pencher directement sur les crimes potentiels de grandes puissances et ne choisit alors que des situations dans lesquelles les poursuites ne « dérangent » pas les États les plus influents de la planète. Selon cette perspective, la CPI serait trop alignée sur les intérêts des États, dont elle est tributaire, en particulier les puissances occidentales.
Cette critique et sa logique sont également valables lorsque la CPI refuse de se saisir d’une affaire[8]. Pour reprendre l’exemple palestinien, si jamais au terme de l’examen préliminaire, la Procureure décidait qu’il n’y a pas matière à ouvrir une affaire, alors plusieurs pourraient formuler la critique selon laquelle la Cour évite de froisser des États influents, en l’espèce Israël et surtout les États-Unis (paradoxalement deux États non-parties au Statut de Rome), affirmant du coup que la CPI « est à genoux devant les plus forts ».
Un autre bon exemple de ce type de critiques est le reproche fait à la CPI de ne concentrer ses ressources qu’en Afrique, là où elle sera la moins gênante. Or, celui qui assume la présidence tournante de l’Union africaine (UA), le président zimbabwéen Robert Mugabe, s’en prend régulièrement à la CPI en l’accusant de n’être qu’un instrument d’acharnement et de contrôle de l’Afrique par l’Occident. Ce dernier aurait par ailleurs exprimé le souhait formel de voir les pays africains se retirer de la CPI pour former une cour alternative continentale avec une compétence similaire. Bien qu’imprégnée d’un langage « très coloré », cette critique correspond à l’école de l’apologia, puisqu’elle s’inscrit dans l’idée que la CPI n’est qu’un appendice du pouvoir étatique (occidental surtout). Concernant l’Afrique également, l’école de l’apologia rappelle que la CPI est en tout temps totalement dépendante du bon vouloir des États ‒ même des plus petits ‒ puisque si des procédures concernant certains pays africains (République démocratique du Congo (RDC), Centrafrique, etc.) ont pu être entamées, c’est précisément parce que cela s’inscrivait plutôt dans le sens des intérêts des gouvernements de ces pays. Selon Robinson, l’admissibilité des affaires devant la Cour, dans les cas où l’État est incapable ou n’a pas la volonté de juger les responsables de graves crimes sous sa juridiction[9], ainsi que sa saisine dans le cas où un État lui défère la situation[10] sont toutes deux liées à la volonté du pouvoir politique de l’État [11].
Toujours dans le cadre de la critique de l’apologia, l’attitude ambivalente des États-Unis face à la Cour pénale internationale depuis la signature du Statut de Rome en 1998 tend à renforcer la thèse de certains quant au caractère politique de la Cour et sa manipulation par les grandes puissances[12]. Après s’être montrés hostiles à la création d’une CPI dès 1998 et avoir, sous l’administration Bush, initiés une série d’ententes bilatérales et de pressions diplomatiques afin de soustraire leurs ressortissants de la compétence de la Cour en toutes circonstances, les dirigeants américains ont soudainement changé d’attitude envers la CPI face à des situations géographiquement plus éloignées. Les « apologistes » pourront ainsi faire remarquer que les États-Unis, qui n’appuieraient la justice internationale pénale que lorsqu’ils y verraient un intérêt[13], ont soudainement trouvé la CPI utile quand elle s’est intéressée au président soudanais Omar al-Bashir, loin d’être un grand ami de la Maison-Blanche[14]. En fait, Washington a même activement milité au Conseil de sécurité pour que ce dernier défère le cas al-Bashir à la CPI. C’est donc ce paradoxe selon lequel les grandes puissances, et de façon plus évidente le gouvernement américain, chercheraient à éviter de se soumettre au régime de la CPI tout en poussant pour que d’autres y soient jugés quand cela sert leur intérêt ‒ comme Omar al-Bashir, bien sûr mais aussi Saïf al-Islam Kadhafi ‒ qui militerait grandement en faveur du renforcement de l’apologia, selon les tenants de cette école.
La CPI : « trop fort » ou « trop doucement » ? … Et qui poursuivre à La Haye ?
Le professeur Robinson a ouvert sa présentation à l’Université Laval en faisant la comparaison suivante[15] : « […] tout dépendant d’où vous êtes, vous avez à peu près entre 50 et 90% de chances de vous faire attraper si vous assassinez une personne. Si vous en tuez mille, vous devriez toutefois vous en tirer assez facilement »[16].
Cette perspective assez frappante revient souvent dans les critiques adressées à la justice internationale pénale, malgré les avancées récentes du droit et la création des tribunaux ad hoc et de la CPI. Darryl Robinson s’est toutefois servi de cette phrase choc pour présenter une autre dyade de critiques dont la CPI peut difficilement se sortir quoiqu’elle fasse, qu’il appelle « too hard v. too easy », toujours dans la logique de Koskenniemi (apologia, utopia).
D’abord, la critique récurrente du too easy (trop facile) s’inscrit dans l’école de pensée de « l’apologie ». Elle consiste à reprocher à la Cour de choisir, dans une situation donnée pour laquelle elle est compétente, de poursuivre les auteurs de crimes internationaux qui ne sont pas « les plus hauts responsables»[17]. Ainsi, dans son propre intérêt, la CPI, très dépendante de la coopération des États pour mener à bien ses poursuites pénales, ne traduirait en justice que les individus « faciles » à appréhender, indisposant donc au minimum les plus hautes sphères politiques de certains pays. En ce sens, on accuse donc la CPI d’être « politique » puisqu’elle prendrait en considération d’autres éléments que la lutte contre l’impunité des auteurs de violations graves du droit international[18]. Ainsi, la critique dénonce le fait que « les petits exécutants » soient poursuivis, contrairement aux hauts responsables des crimes commis (les états-majors, les chefs d’État, etc.).
Par exemple, considérons des cas ayant mené à des procès à La Haye, comme l’affaire Lubanga ou les affaires Ngudjolo et Katanga. Plusieurs critiques de la CPI affirment que le Bureau du Procureur et la Cour ont pu exercer leur compétence sans embûche dans ces affaires parce qu’aucun de ces trois individus n’étaient de « gros poissons », des gens politiquement importants pour le gouvernement Kabila en RDC. La même remarque s’applique également pour la mise en accusation de Jean-Pierre Bemba Gombo en République centrafricaine. Du point de vue de l’école de l’apologia, c’est précisément parce que cela arrangeait plutôt bien les dirigeants à Bangui et à Kinshasa que la CPI a pu obtenir l’exécution du mandat d’arrêt contre eux.
À l’opposé, on retrouve les critiques formulées par l’école de « l’utopie » (utopia), qui reprochent à la Cour d’y aller « trop fort » (too hard) dans certains cas, la rendant déconnectée de la réalité et même « dangereuse » dans des situations de conflits où la paix reste à établir[19]. Cette critique est utilisée fréquemment pour reprocher à la CPI de vouloir trop imposer par le haut son « agenda » de lutte contre l’impunité à tout prix en faisant abstraction des conséquences qui pourraient suivre de la part des États. Ainsi, on lui reproche son « imprudence » pouvant mettre en péril la crédibilité de la justice internationale pénale. Paradoxalement ici aussi, on reproche à la CPI d’être « politique » justement pour ne pas suffisamment prendre en considération des éléments externes, comme le processus de paix au Darfour par exemple, la légitimité de la Cour en Afrique ou en Occident, ou le retrait éventuel de certains États de la CPI. Elle tire son origine de la mise en accusation par le Bureau du Procureur de chefs d’États dans les dernières années, à commencer par la délivrance d’un mandat d’arrêt international contre le président du Soudan, Omar al-Bashir, pour les atrocités commises dans le cadre du conflit au Darfour. Pour les raisons évoquées plus haut, soit la dépendance de la Cour envers la coopération des États pour exécuter les mandats d’arrêt internationaux, le fait qu’un mandat soit émis contre le président du Soudan a été vu par certains comme trop déconnecté de la réalité politique internationale pour être efficace. Comment un État (et ses proches alliés) pourrait accepter de remettre son propre président à la CPI? Selon cette perspective critique, donc, la Cour y va trop fort et nuit à sa propre cause.
 Omar al-Bashir (©UN Photo / Stuart Price)
Omar al-Bashir (©UN Photo / Stuart Price)
Un autre argument présenté dans le cas précis d’Omar al-Bashir est que l’on reproche à la CPI d’avoir envenimé la situation au Darfour. Selon plusieurs, la Cour aurait agit prématurément sans égard aux conséquences que pourrait avoir sur le sort des populations et sur l’accès humanitaire dans les zones de conflit le fait de viser spécifiquement un chef d’État en exercice. Le même reproche « d’aveuglement juridique » a été fait au sujet des accusations déposées contre Uhuru Kenyatta, président du Kenya en exercice. A contrario, le dépôt d’accusations contre l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est venu accréditer la critique « apologiste » puisque Gbagbo a été accusé après avoir perdu le pouvoir, alors que son rival politique lui succédait à la présidence au terme d’une crise électorale (appuyant ainsi une apparente convergence d’intérêts avec les États).
Peu importe ce que fait la CPI afin de minimiser les critiques en matière de sélection des situations et des affaires, il sera toujours possible de lui reprocher l’exact opposé, selon le cas. La connaissance de cette dyade apologia / utopia prend tout son sens lorsque nous sommes confrontés à certaines critiques courantes au sujet de la CPI et permet plus de profondeur et de discernement au moment de les appréhender. Au fond, la réalité demeure que ces critiques sont généralement également vraies, et également fausses.
Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.
[1] Darryl Robinson, « Inescapable Dyads: Why the ICC cannot win » (2015) 28:2 Leiden Journal of International Law pp. 323-347.
[2] Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of Legal Argument, 1ère éd., 2005, Cambridge, Cambridge University Press.
[3] Traduction libre de « utopia » et « apologia ».
[4] D. Robinson, supra note 1, p. 6.
[5] Ibid.
[6] Voir articles 12 à 15 et 53 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998.
[7] D. Robinson, supra note 1, p. 22.
[8] Ibid.
[9] Article 17 du Statut de Rome.
[10] Articles 13 et 14 du Statut de Rome.
[11] À noter que le Conseil de Sécurité de l’ONU peut aussi déférer une situation à la CPI, tout comme le Procureur peut agir proprio motu.
[12] Margarete Lengger, Peace through International Criminal Law? The International Criminal Court as a Capacity for Peace in the International Relations, Saarbrücken, VDM, 2010, pp. 58-59.
[13] Pour plus d’informations sur le sujet, voir William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court.
[14] Ibid., p. 64.
[15] Traduction libre de l’anglais au français.
[16] Darryl Robinson, citation orale, 23 mai 2015. (traduction libre par l’auteur)
[17] D. Robinson, supra note 1, p. 24.
[18] Ibid.
[19] Ibid.

